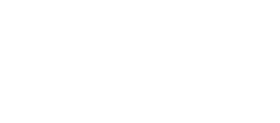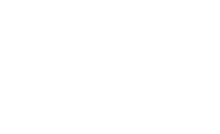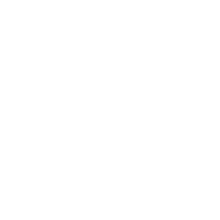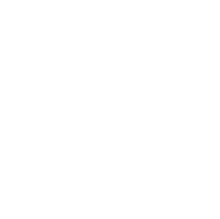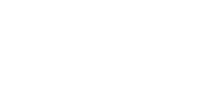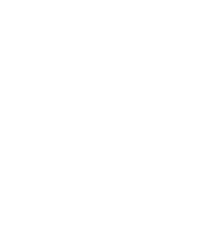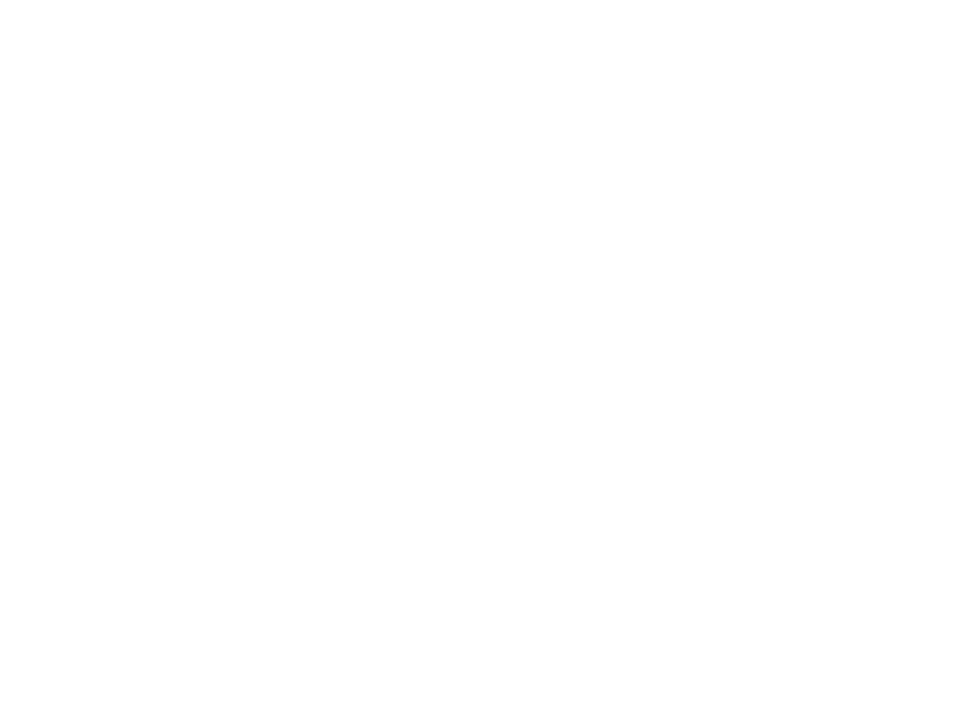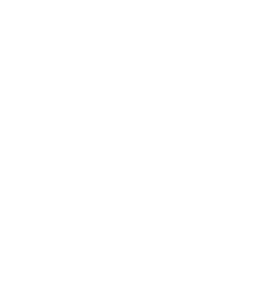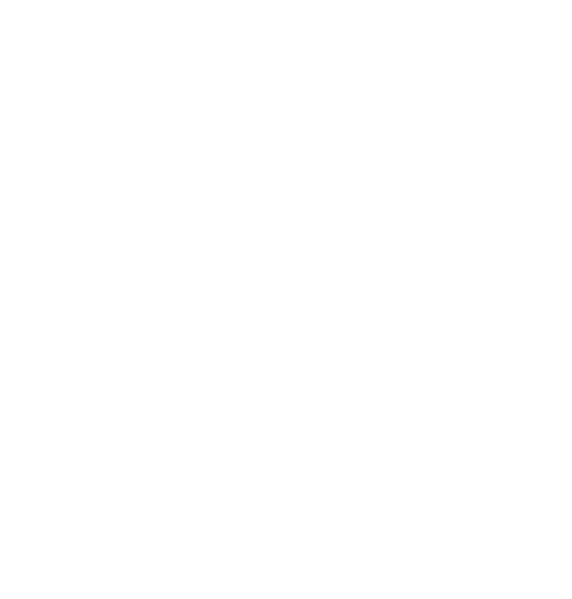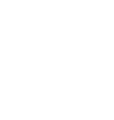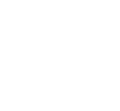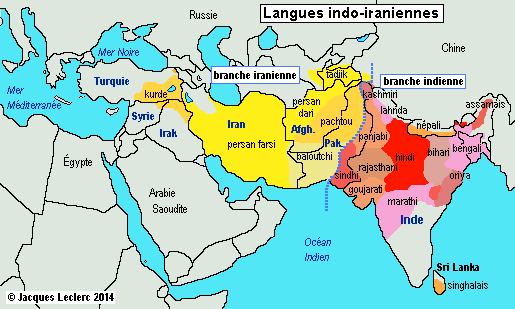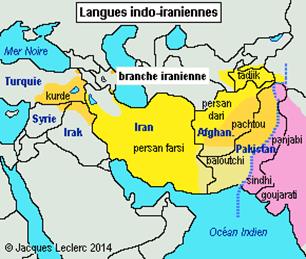Langues indo-européennes
Pour les articles homonymes, voir Indo-européen.
Ne doit pas être confondu avec Langues d'Europe.
Le fond de cet article d'histoire est à vérifier (décembre 2012).
Améliorez-le ou discutez
des points à vérifier. Si vous venez d’apposer le
bandeau, merci d’indiquer ici les points à vérifier.
Cet article ne cite pas
suffisamment ses sources (décembre 2012).
Si vous disposez d'ouvrages ou
d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant
du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références
utiles à sa vérifiabilité et
en les liant à la section « Notes et
références »
En pratique : Quelles sources
sont attendues ? Comment
ajouter mes sources ?
|
Langues indo-européennes |
|
|
Région |
Europe, Asie mineure, monde iranien, Asie centrale, Inde du Nord ; extension au Nouveau Monde partir du xvie siècle1. |
|
Classification par famille |
|
|
·
-langues indo-européennes o
-albanais (langues
paléo-balkaniques) o
-langues anatoliennes (éteintes) o
-arménien o
-langues romanes (langues italiques) o
-langues tokhariennes (éteintes) |
|
|
Codes de langue |
|
|
ine |
|
|
ine |
|
|
Carte |
|
|
Répartition des langues indo-européennes dans le monde. ·
Majorité de locuteurs d'une langue indo-européenne. ·
Minorité de locuteurs d'une langue indo-européenne ayant un statut
officiel. ·
Minorité significative de locuteurs d'une langue indo-européenne sans
statut officiel. |
|
L'expansion des
langues indo-européennes d'après l'hypothèse kourgane introduite
par Marija Gimbutas.
Distribution approximative actuelle des branches indo-européennes dans
leurs terres d'origines en Europe et en Asie :
·
Albanais
·
Arménien
·
Langues balto-slaves (langues baltes)
·
Langues balto-slaves (langues slaves)
·
Langues italiques (langues romanes)
·
Langues non indo-européennes
Les zones hachurées ou
en pointillé, indiquent les régions où le multilinguisme est fréquent ou la norme.
Distribution approximative actuelle des langues indo-européennes parlées en
Amérique :
·
Espagnol
·
Anglais
·
Français
En linguistique, les langues
indo-européennes forment une famille de langues étroitement
apparentées2 ayant pour origine ce qu'il est
convenu d'appeler l'indo-européen commun et « dont
les éléments lexicologiques, morphologiques et syntaxiques présentent, pour la
plupart d'entre elles, des ressemblances de nature telle que ces langues
peuvent se ramener à l'unité ; le présupposé est alors que chaque groupe
d'éléments comparés procède d'évolutions divergentes à partir de formes originelles
disparues3 ». Au nombre d'environ un millier,
elles sont actuellement parlées par près de trois milliards de locuteurs4.
Sommaire
·
1Généralités et
théorie actuelle
·
2Nom de la
famille et son origine
·
3Genèse et
histoire de l'étude des langues indo-européennes
·
4Classification
systématique des langues indo-européennes par branches
§ 4.2.1Sous-branche
paléo-balkanique
§ 4.4.2Langues romanes
(issues du latin)
o 4.5Langues
pré-celtiques indo-européennes
o 4.7Branche
helléno-phrygienne
§ 4.9.1Sous-branche
indo-aryenne
Généralités et théorie actuelle[modifier | modifier le code]
La famille des langues indo-européennes
est généralement subdivisée en huit branches :
1. l'albanais ;
2. l'arménien ;
3. les langues balto-slaves ;
4. les langues celtiques ;
5. les langues germaniques ;
6. les langues helléniques ;
7. les langues
indo-iraniennes ;
8. les langues romanes (italiques).
Elle possède également deux branches
majeures éteintes :
1. les langues anatoliennes ;
2. les langues tokhariennes.
À ces branches majeures s'ajoutent un
certain nombre de langues attestées uniquement de manière fragmentaires, comme
les langues illyriennes ou
le phrygien, dont la classification reste
incertaine.
L'une des théories les plus importantes
pour la linguistique comparée concerne
l'opposition entre les langues dites satem et
celles dites centum, du mot servant à dire
« cent ». Cette opposition sépare, selon une isoglosse nette, le groupe satem (qui
se situe à l'est et au sud-est de l'aire de répartition des langues
indo-européennes, et comprend l'albanais, les langues anatoliennes,
l'arménien, les langues balto-slaves et
les langues
indo-iraniennes) du groupe « centum » (qui se situe en
majorité au centre et à l'ouest de l'aire de répartition des langues
indo-européennes, et comprend les langues celtiques, les langues germaniques,
les langues helléniques,
les langues italiques et
les langues tokhariennes,
ces dernières étant les seules du groupe à avoir été parlées en Asie centrale). Par ailleurs les langues
germaniques, qui appartiennent au groupe centum, et les
balto-slaves, qui appartiennent au groupe satem, ont en commun
certains traits syntaxiques qui les distinguent de toutes les autres langues de
la famille.
L'ensemble des langues indo-européennes
sont des langues dites flexionnelles.
L'arménien est l'unique langue
indo-européenne qui soit agglutinante (c'est-à-dire
qu'elle se présente sous la forme d'éléments de base, les morphèmes), à la différence des autres langues
indo-européennes, lesquelles sont spécifiquement des langues dites synthétiques ou
fusionnelles (c'est-à-dire dont les déclinaisons grammaticales fonctionnent par
affixes et par suffixes sur un seul élément de base). Ces typologies
linguistiques mettent en lumière la complexité de la genèse puis de l'évolution
de la famille indo-européenne. Cependant, ces différents postulats
typologiques, notamment la différenciation « satem/centum », ont été
remis en question, au moins partiellement, durant les années 19801.
De nombreux indices laissent supposer
que toutes ces langues proviennent d'une unique langue mère5 ; néanmoins, en l'absence de toute
trace écrite de celle-ci, cela demeure une hypothèse.
Les racines des langues indo-européennes
dateraient vraisemblablement de la fin du néolithique et du chalcolithique. En pratique, l'indo-européen commun est
donc, à l'instar de diverses autres langues et idiomes, reconstitué par
recoupements (phonétiques, grammaticaux, etc.) entre ses différentes langues
filles, par le biais de la linguistique comparée,
entre autres. C'est en effet un produit, sans doute le plus achevé, de la linguistique comparée,
laquelle est une discipline qui s'est essentiellement développée entre la fin
du xviiie siècle et
le début du xixe siècle.
L'existence de cette langue mère avec son vocabulaire propre, conjuguée aux
nombreux autres traits culturels, religieux et anthropologiques qui se sont
probablement répandus en même temps qu'elle, permettent d'envisager l'existence
d'un ancien peuple indo-européen, avec une identité ethnique,
culturelle, linguistique, sociale et religieuse qui lui est propre. Ce peuple
se serait répandu sur de vastes territoires en Eurasie, diffusant sa langue,
ancêtre de toutes les langues indo-européennes, et sa culture, probablement
influencée par celles des ethnies autochtones. Il existe différentes hypothèses
quant à la localisation du foyer et à la culture archéologique précise qui correspondraient
à ce peuple originel. De nos jours c'est l'hypothèse Kourgane qui
obtient de loin les plus grandes faveurs des spécialistes6.
Nom de la famille et son origine[modifier | modifier le code]
Le terme « indo-européen »
pour désigner cette famille de langues est une traduction du terme
anglais Indoeuropean (ou Indo-European), qui fut
introduit pour la première fois en 1813 par Thomas Young7 et qui a supplanté les termes plus
anciens comme « japhétique » ou « scythe ». L'équivalent
allemand indogermanisch est une traduction du français
« indo-germanique », proposé en 1810 par le géographe Conrad Malte-Brun8, mais qui n'a pas réussi à s'imposer en
français malgré un usage relativement fréquent au xixe siècle. D'autres termes attestés historiquement mais aujourd'hui
obsolètes incluent «indo-celtique», « aryen » ou encore
« sanskritique »9,10.
Genèse et histoire de l'étude des langues
indo-européennes[modifier | modifier le code]
Répartition des
langues indo-européennes vers -1500.
Répartition des
langues indo-européennes vers -500.
Répartition des
langues indo-européennes vers 500.
Arbre des langues
indo-européennes.
Les tout premiers travaux concernant
l'existence d'une langue ancestrale et commune aux différentes langues
européennes — et uniquement européennes pour ces travaux —, ont été
réalisés au xvie siècle par Joseph Scaliger. Il mit en lumière des liens
évidents entre les langues européennes (langues mortes et vivantes) et établit
en outre une classification de ces dernières en quatre groupes par le biais
du phonème signifiant dieu : le
groupe deus (langues romanes), le groupe germanique gott,
le groupe théos (dont le grec) et enfin le groupe slave bog1.
Au xviie siècle le linguiste Marcus Zuerius
van Boxhorn subodore l'existence d'une ancienne langue commune
aux langues grecque, latine, perse, germaniques, slaves, celtes et baltes11, qu'il baptise du nom de
« scythique »12. Ses travaux restent cependant sans
suite et inaboutis.
Au xviiie siècle, William Jones identifie
à nouveau la famille indo-européenne. Dans son Troisième discours à la société
asiatique de Calcutta, en 1786, il écrivait13 :
« La langue sanskrite, quelle que soit son antiquité, est d'une
structure admirable ; plus parfaite que la grecque ; plus ample que
la latine, et plus exquisément raffinée qu'aucune des deux mais ayant envers
chacune d'entre elles deux une affinité plus forte, tant dans les racines des
verbes que dans les formes de la grammaire, qu'il n'en pourrait avoir résulté
par accident ; si forte en vérité qu'aucun philologue ne les pourroit
examiner toutes trois sans croire qu'elles ont surgi de quelque source commune,
qui, peut-être, n'existe plus. »
C'est à William Jones que
revient l'invention de la linguistique comparée1.
En 1767, l'Anglais James
Parsons (en),
membre honoraire et pair de la Royal Society et de la Society of
Antiquaries, publia un livre dans lequel il décrivait ses travaux
sur une probable langue commune indo-européenne ; cependant, même si
celui-ci fit avancer la théorie indo-européenne, l'ouvrage en question
contenait d'importantes erreurs d'interprétation1.
Les comparaisons systématiques conduites
par Franz Bopp sur ces langues confirmèrent
cette hypothèse et sa Grammaire comparée des langues sanscrite, persane
(zende d'Avesta), grecque, latine, lituanienne, slave, gothique, et allemande,
publiée entre 1833 et 1852, marqua le début des études indo-européennes. Karl Brugmann fonde leur étude comparée.
Également au cours du xixe siècle, August Schleicher poussa l'étude comparative en
élaborant un procédé de reconstruction linguistique, la Stammbaumtheorie (de),
ou triangulation linguistique, sur la base de mots usuels et familiers, comme
le terme « mouton ». Néanmoins, ce nouveau procédé était lui aussi
appelé à devenir obsolète, dès lors que les recherches devenaient plus
globalisantes1.
À la fin du xixe siècle, le philologue et
linguiste Johannes Schmidt,
éclaira les études sur les langues indo-européennes d'un jour nouveau, en
s'appuyant non plus sur un tableau de classification par ramifications comme
cela avait été antérieurement proposé par ses prédécesseurs, mais sur une
classification par « vague ». Cette nouvelle base de travail permit
d'intégrer les interactions et les influences réciproques des langues
indo-européennes, mais également d'inclure l'ascendance, aussi minime
soit-elle, des langues non-indo-européennes. La thèse de Schmidt faisait de
l'étude comparative une science plus proche de la réalité des faits ; il
mettait ainsi en évidence, par exemple, les liens de causalité entre
l'apparition d'éléments ou de termes italiques dans certaines langues celtiques et
les répercussions de faits historiques, commerciaux et culturels entre les deux
groupes ethniques des celtes et des italiques durant l'Antiquité1. La théorie des vagues
compétitives ira plus loin que Johannes Schmidt en rejetant entièrement
la Stammbaumtheorie.
En 1846,
le vieux perse, langue parlée vers le ve siècle av. J.-C., est
déchiffré puis, du fait de ses similitudes et caractéristiques qui le rapproche
de la famille linguistique indo-européenne, est intégré à cette dernière. Par
la suite, en 1917, la langue hittite subit le même traitement.
Enfin, au cours du milieu du xxe siècle, c'est au
tour du mycénien d'intégrer
la famille indo-européenne.
Classification systématique des langues
indo-européennes par branches[modifier | modifier le code]
Schéma récapitulatif[modifier | modifier
le code]
D'après Bernard Sergent, Les
Indo-Européens : Histoire, langues, mythes, Paris, Payot, 1995.
─o
indo-européen I
└─o indo-européen II
├─o indo-européen III
│
├─o nord-ouest
│
│ ├─o italo-celtique
│
│ │ ├─o celtique commun
│
│ │ └─o italique commun
│
│ ├─o tokharien†
│
│ │ ├─o agnéen (tokharien A)
│
│ │ └─o koutchéen (tokharien B)
│
│ └─o germanique commun
│
│ ├─o estique†
│
│ ├─o nordique
│
│ │ ├─o
scandinaves occidentales
| | | | ├─o norne†
| | | | ├─o nynorsk
| | | | ├─o islandais
| | | | └─o féroïen
│
│ │ └─o
scandinaves orientales
| | |
├─o danois
| | |
├─o bokmål
| | | ├─o
suédois
| | |
└─o gutnisk
│
│ └─o westique
|
├─o balto-balkanique
│
│ ├─o balkanique†
│
│ │ ├─o daco-mycien
│
│ │ └─o thrace
│
│ └─o balto-slave commun
│
│ ├─o balte commun
│
│ │ ├─o balte
occidental†
│
│ │ └─o balte
oriental
| | |
├─o lituanien
| | |
└─o letton
│
│ └─o slave commun
│
│ ├─o slave
méridional
│
│ │ ├─o
slovène
│
│ │ ├─o
serbo-croate
│
│ │ └─o
bulgaro-macédonien
│
│ ├─o slave
occidental
│
│ │ ├─o léchitique
│
│ │ ├─o
sorabe
│
│ │ └─o
tchèque / slovaque
│
│ └─o slave
oriental
│
│ ├─o russe
│
│ ├─o biélorusse
│
│ └─o ukrainien /
ruthène
│
└─o nord-est
│ ├─o pontique
│ │ ├─o hellénique
│ │ │ ├─o grec
│ │ │ └─o ancien
macédonien†
│ │ └─o phrygo-arménien
│ │
├─o phrygien†
│ │
└─o arménien
│ └─o indo-iranien commun
│ ├─o iranien commun
│ ├─o nouristani
│ └─o indo-aryen commun
└─o anatolien commun†
├─o hittite
├─o louvite
│
├─o
│
│ ├─o louvite hiéroglyphique
│
│ └─o
│
│ ├─o lycien
│
│ └─o sidétique
│
└─o
│ ├─o
lykaonien
│ ├─o
sud-phrygien
│ ├─o isaurien
│ └─o cilicien
├─o palaïte
└─o lydien
Branche balto-balkanique[modifier | modifier
le code]
Un point d'interrogation (?) signale une
incertitude sur le regroupement.
Sous-branche paléo-balkanique[modifier | modifier le code]
Article détaillé : Langues
thraco-illyriennes.
o
dace
o
mésien
o
dardanais (hypothèse)
o
thrace
§
thrace d'Europe : besse, odrysse, édone, satre, bisalte, odomante
§
péonien (ou thraco-illyrien)
§
thrace d'Asie : thynien, bithynien
·
groupe adriatique
o
illyrien
§
liburnien (discuté)
§
albanais
§
guègue
§
tosque
Sous-branche balte[modifier | modifier
le code]
Article détaillé : Langues baltes.
o
sudovien (yotvingien)
o
curonien
o
letton (lette)
o
sélonien
o
skalvien
Sous-branche slave[modifier | modifier
le code]
Article détaillé : Langues slaves.
o
kachoube (cachoube)
o
polonais
o
polabe
o
sorabe
o
slovaque
o
tchèque
§
bulgare
§
croate
§
serbe
§
bosnien
o
slovène
o
russe
o
ruthène
Branche germanique[modifier | modifier
le code]
Article détaillé : Langues germaniques.
§
anglo-saxon
§
anglais
§
scots
§
bas-allemand (Niederdeutsch,
Plattdeutsch)
§
groupe oriental
§
brandebourgeois
§
bas-francique
§
haut-allemand (Hochdeutsch)
§
silésien
§
yiddish
§
allemand
§
alsacien
§
souabe
§
bavarois
·
groupe nordique ou
scandinave
o
sous-groupe occidental
§
norvégien nynorsk (landsmål)
§
féroïen
o
sous-groupe oriental
§
danois
§
norvégien bokmål (riksmål) (le samnorsk peut
y être rattaché)
§
suédois
o
gotique
o
burgonde
o
vandale
Branche italo-celtique[modifier | modifier
le code]
Article détaillé : Langues
italo-celtiques.
Sous-branche italique[modifier | modifier
le code]
Article détaillé : Langues italiques.
o
ombrien
o
osque
o
sabin
o
samnite
o
volsque
o
marse
o
marrucin
o
èque
o
lucanien
o
falisque
o
vénète (discuté)
o
élyme (discuté)
o
dalmato-pannonien (hypothèse)
o
latin (dont sont issues les langues
romanes)
·
Bloc du nord-ouest (Belges), hypothétique, et peut-être italique.
Langues romanes (issues du latin)[modifier | modifier le code]
Article détaillé : Langues romanes.
o
espagnol (castillan)
§
asturien
§
léonais
§
galicien
§
fala
·
langues gallo-romanes (?)
§
français
§
créoles à
base lexicale française
§
Parlers centraux
§
angevin
§
manceau
§
gallo
§
normand
§
jersiais
§
picard
§
wallon
§
poitevin
§
occitan ou langue d'oc
§
limousin
§
marchois
§
marchois
§
gascon
§
aranais
§
nissart
o
romanche
o
ladin
o
frioulan
§
lombard
§
ligure
§
émilien
§
romagnol
o
vénitien
§
istriote
o
toscan
§
italien (langue standard, basée sur le
toscan et créée par Dante)
§
corse
o
dialectes centro-méridionaux
§
dialectes
italiens médians : marchigiano, ombrien, dialecte sabin et « romain du
Latium » (le « romanesco » est un dialecte du toscan)
§
dialectes
italiens méridionaux :
§
abruzzais (dialecte du méridional)
§
apulien (dialecte
du méridional ou
napolitain)
§
dialectes lucaniens ou
lucanien (dialectes du méridional) (deux variétés)
§
extrême-Sud :
o
salentin
§
calabrais méridional
§
sicilien
o
daco-roumain (dit roumain ou moldave)
o
aroumain (ou valaque)
o
mégléno-roumain (ou
méglénite)
o
istro-roumain (ou istrien)
o
illyro-roman (ou dalmate)
o
sarde
§
logoudorien dont
le nuorais
Sous-branche celtique[modifier | modifier
le code]
Article détaillé : Langues celtiques.
Répartition tirée en partie de celle de
Jean-Louis Brunaux15 :
·
Langues
celtiques insulaires
§
gallois
§
cornique
§
breton
§
cambrien (langue
éteinte)
§
picte (discuté ; langue éteinte)
o
goidélique ou gaélique (parlé
en Écosse et Irlande)
§
irlandais (et sa forme ancienne)
§
écossais (ou
erse)
§
mannois (ou manxois)
·
Langues
celtiques continentales
o
gaulois (langue
éteinte parlée en France, en Belgique, en Suisse et dans la plaine du Pô, en
Italie, de 300 av. J.-C. à 400 ap. J.-C.)
o
lépontique (langue éteinte parlée dans la
région des lacs italiens de 700 à 400 av. J.-C.)
o
celtibère (langue éteinte parlée en
Espagne de 300 à 100 av. J.-C.)
o
norique
o
galate
Langues pré-celtiques indo-européennes[modifier | modifier le code]
·
tartessien (hypothèse)
Branche arménienne[modifier | modifier
le code]
·
arménien
Branche helléno-phrygienne[modifier | modifier le code]
Article détaillé : Langues helléniques.
o
groupe arcadochypriote
§
mycénien
§
arcadien, cypriote, pamphylien
o
groupe ionien-attique :
§
attique (grec ancien)
§
koinè (moyen grec commun)
§
ionien (d'Asie,
insulaire, d'Eubée)
o
groupe éolien (béotien, lesbien, thessalien)
o
groupe occidental
§
dorien (laconien, argien, corinthien,
etc.)
§
éléen, étolien, locrien, phocidien
·
phrygien
Branche tokharienne[modifier | modifier
le code]
Article détaillé : Tokhariens.
·
tokharien A (agnéen ou tokharien
proprement dit)
·
tokharien B (koutchéen ou kuci)
Branche indo-iranienne[modifier | modifier
le code]
Article détaillé : Langues
indo-iraniennes.
Sous-branche indo-aryenne[modifier | modifier le code]
Article détaillé : langues indo-aryennes.
·
vieil-indien (sanskrit védique,
sanskrit classique)
o
moyen-indien (prâkrits,
apabhraṃśa)
§
pâli
§
néo-indien occidental :
§
bhili
§
gujarâtî
§
dhivehi ou mahl
§
lahnda
§
marâthî
§
sindhî
§
awadhi
§
kananuji
§
haryanvi
§
néo-indien central :
§
hindî, ourdou, hindoustani
§
pahari
§
bangani
§
népalais
§
penjâbî
§
kankani
§
néo-indien oriental :
§
assamais
§
bengalî
§
bihârî
§
oriya
§
kâshmîrî
§
romani (tsigane) (langues difficiles à
classer, à rapprocher soit du groupe dardique, soit de l'hindî ou du
râjasthâni)
Sous-branche iranienne[modifier | modifier
le code]
Article détaillé : Langues iraniennes.
o
moyen-perse ou pehlevi
o
persan : farsi, dari, tadjik, judéo-persan, hazara
o
tat
o
parthe
o
kurde : kurmandji, soranî, gurani
o
zazaki
o
Dialectes tati
o
talysh
o
Gilaki
o
semnani
o
Dialectes de la région de Semnan : sourkhei, lasgerdi, biyabuneki, aftari, sangisari
o
Dialectes de l'Iran central : yazdi, yarandi, farizandi, kohrudi, keshei, meimei, jawshakani, khunsari, vonishuni, zefrei
o
sivandi
o
parachi
o
ormuri
o
bactrien
o
khotanais ou sace
o
sogdien
§
yaghnobi
o
pashto
o
langues
du Pamir (en) : wakhi, sangletchi, ishkashimi, shughni, sariqoli, yazghulami
o
scythe et alain
Branche anatolienne[modifier | modifier
le code]
Article détaillé : Langues anatoliennes.
·
Hittite,
également appelé nésite ou hittite-nésite.
·
Palaïte
·
Louvite
o
mylien
§
isaurien
§
cilicien
o
lycien
·
Lydien
·
Pisidien
·
Carien
·
Pré-hellénique A (?
voir aussi langues
pré-indo-européennes)
Notes et références
Langues indo-aryennes
Cet article ne cite pas
suffisamment ses sources (mars 2019).
Si vous disposez d'ouvrages ou
d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant
du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références
utiles à sa vérifiabilité et
en les liant à la section « Notes et
références »
En pratique : Quelles sources
sont attendues ? Comment
ajouter mes sources ?
|
Langues indo-aryennes |
|
|
Pays |
Afghanistan, Pakistan, Inde du Nord, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives |
|
Classification par famille |
|
|
§ -langues indo-aryennes |
|
|
Codes de langue |
|
|
inc |
|
|
inc |
|
|
Carte |
|
Les langues indo-aryennes constituent
une branche des langues
indo-iraniennes, qui font elles-mêmes partie de la famille des langues
indo-européennes. Elles sont essentiellement parlées en Asie du Sud : dans les deux tiers nord de
l'Inde, au Pakistan, dans le nord-est de l'Afghanistan, au Bangladesh, au Népal, au Sri Lanka, aux Maldives.
Ces langues rassemblent environ la
moitié (environ 1,5 milliard) des locuteurs de toutes les langues
indo-européennes. Les plus importantes par le nombre sont l'hindoustani (hindi et ourdou, environ 240 millions de personnes),
le bengali (environ 230 millions), le pendjabi (environ 90 millions), le marathi (70 millions), le gujarati (environ 45 millions), l'oriya (environ
30 millions), le sindhi (environ 20
millions), le népalais (environ 14
millions), le cinghalais (environ
16 millions), le saraiki (environ 14
millions) et l'assamais (environ 13 millions).
Les langues indo-aryennes forment le
sous-groupe numériquement le plus important des langues indo-iraniennes,
lesquelles comportent également deux autres sous-groupes : les langues iraniennes et
les langues nouristanies.
Sommaire
o 2.2Groupe
septentrional ou pahari
Classification par époques[modifier | modifier le code]
Il est d'usage de distinguer trois
époques successives dans le développement des langues indo-aryennes1.
Ancien indien[modifier | modifier
le code]
De forme archaïque, il est représenté
par les différentes variétés de sanskrit :
·
védique : c'est la langue du Veda, dont la forme la plus ancienne
s'observe dans le Rig-Veda ;
·
épique : la langue des grandes épopées de l'Inde ancienne, le Mahabharata et le Ramayana ;
·
classique : fixé par les descriptions des grammairiens Panini et
ses commentateurs Katyayana et Patañjali, c'est par excellence la langue classique de l'Inde. Au fur et à
mesure des siècles, il est de plus en plus influencé par les langues vernaculaires,
ne conservant intacts de l'ancien indien que la phonologie et la morphologie.
Moyen indien[modifier | modifier
le code]
Phonétiquement et grammaticalement plus
dérivé, il est représenté d'abord par les prâkrits, issus des vernaculaires de l'Inde
classique mais stylisés comme langues littéraires, typiquement
limitées à des usages définis :
·
le prâkrit des inscriptions d'Ashoka au iiie siècle av.
J.-C. est le plus anciennement attesté par l'épigraphie
·
le prâkrit des inscriptions postérieures à Ashoka et jusqu'au ve siècle (remplacé ensuite dans ce
rôle par le sanskrit)
·
le pali, langue du Tipitaka bouddhique, apparemment originaire du centre
de l'Inde, mais influencé par des variétés plus orientales et par le sanskrit
·
le gandhari,
langue bouddhique du Gandhara, connue par une
édition du Dhammapada
·
le prâkrit de Niya, proche du
gandhari mais un peu plus tardif, employé comme langue administrative au Turkestan chinois
·
l'ardhamagadhi,
originaire du Koshala, langue du
canon jaïn
·
le magadhi, langue du Bihar et
vraisemblablement de l'empire Maurya,
précurseur de l'actuel magahi, utilisé comme
« prâkrit dramatique » dans le théâtre indien pour
représenter le parler des personnages d'humble condition
·
le shauraseni,
originaire du centre de l'Inde (comme le pali mais à un état postérieur),
« prâkrit dramatique » standard, également cultivé par les jaïns
·
le maharashtri,
originaire du sud-ouest de l'Inde, précurseur du marathi, troisième « prâkrit
dramatique », également employé dans la poésie lyrique et (mêlé à l'ardhamagadhi)
par les jaïns
·
le prâkrit cingalais, employé dans
des inscriptions au Sri Lanka à
partir du ier siècle.
On peut y ajouter le « sanskrit
bouddhique hybride », employé dans la littérature du bouddhisme Mahayana, sorte de représentation sous une
forme sanskrite de dialectes moyen indiens.
Plus tardivement, aux vie au xiiie siècles,
le moyen indien est représenté par des formes encore plus évoluées qui font la
transition avec les langues modernes :
·
en Inde du Nord les apabhramshas
·
au Sri Lanka, l'elu.
Néo-indien[modifier | modifier
le code]
Il rassemble les langues modernes et
leurs ascendants immédiats.
Répartition actuelle[modifier | modifier
le code]
Distribution des principales langues indo-aryennes modernes avec leur
répartition en sous-branches :
·
groupe darde
·
groupe septentrional (ou pahari)
·
groupe nord-occidental
·
groupe occidental
·
groupe central (« hindi »)
·
groupe oriental
·
groupe méridional
Les langues indo-aryennes modernes
peuvent se répartir par sous-branches selon une logique largement géographique,
mais leur délimitation n'est pas toujours assurée : elles forment
une zone linguistique où
il y a souvent intelligibilité
mutuelle de proche en proche, de sorte qu'il est malaisé de
tracer des frontières
linguistiques. La classification qui suit2 n'est qu'une indication possible.
·
dameli
·
kalasha
·
katarqalai ou
wotapuri
·
khowar
·
kohistani de Kalam ou
kalami
·
kohistani de l'Indus ou
mayã
·
pashai
·
phalura
·
sawi
·
shina
·
brokskat
Groupe septentrional ou pahari[modifier | modifier le code]
Il s'agit d'un groupement géographique
de trois ensembles de langues parlées dans l'Himalaya. Le mot pahar signifie
« montagne » dans de nombreuses langues locales.
·
pahari occidental
o
dogri et kangri -
également rattachés au pendjabi
o
jaunsari
o
sirmauri
o
baghati
o
kiunthali ou mahasui
o
handuri
o
kului
o
mandeari
o
chameali
o
bharmauri (ou gadi)
o
churahi
o
pangwali
o
bhalesi
o
khashali
o
padri
·
pahari central
o
garhwali
o
kumaoni ou kumauni
·
pahari oriental
o
népalais
Groupe nord-occidental[modifier | modifier
le code]
·
kutchi
·
lahnda ou pendjabi occidental
o
saraiki
§
multani
§
thali
§
derawali
o
shahpuri
o
khetrani -
peut-être à rattacher aux langues dardes
o
pothohari ou pothwari
o
hindko propre
§
ghebi
§
chachhi
§
kohati
o
dhanni
o
sawain ou sohain
o
tinauli
o
chibhali
o
punchhi
·
sindhi
Groupe occidental[modifier | modifier
le code]
·
pendjabi — plus précisément pendjabi
oriental, quand le terme de pendjabi est employé pour
couvrir aussi les dialectes lahndas (assez différents), qui sont alors
considérés comme formant le pendjabi occidental
o
marwari,
également compté à part du rajasthani
o
bagri
o
mewari
o
rajasthani centre-oriental
§
dhundhari ou jaipuri
§
harauti
§
mewati
§
malvi
§
nimadi
o
formes des nomades, géographiquement disjointes
§
gojri ou gujari
§
lambadi, lamani ou banjari
o
bhili
o
wagdi
o
varli
o
dhanki (ou dangi)
o
etc.
·
gujarati (également écrit goudjerati)
·
saurashtra -
forme de gujarati transplantée en Inde du Sud
·
khandeshi -
intermédiaire avec le marathi
Groupe central[modifier | modifier
le code]
Ce groupe recouvre partiellement
la ceinture du hindi (en anglais : Hindi Belt),
définie selon une logique de typologie
sociolinguistique comme l'ensemble de régions où le hindi sert
de langue-toit : une langue standard faisant office de forme
écrite commune pour un continuum
linguistique diversifié. Antérieurement, c'est le braj bhasha et l'awadhi qui tenaient ce rôle dans ces
régions.
La terminologie est compliquée par
l'ambiguïté des termes « hindi » ou « hindoustani »,
employés d'une part au sens restreint pour désigner cette norme écrite, d'autre
part au sens large pour regrouper toutes ces variétés linguistiques, qui en
sont alors considérées alors comme des dialectes. Ici, on emploiera le mot au
sens restreint seulement.
La ceinture du hindi s'étend cependant
au-delà du groupe central de l'indo-aryen, en direction du rajasthani, du bihari et du pahari.
·
Différentes conceptions de l'extension du hindi
La ceinture du hindi.
Le groupe central de
l'indo-aryen.
Région où
l'hindoustani est langue maternelle.
Les langues du groupe central de
l'indo-aryen parlées en Inde sont les suivantes :
·
haryanvi ou bangaru
o
khariboli, également appelé kauravi ou hindoustani
vernaculaire
Les langues indo-iraniennes (indo-aryennes)
|
Groupe |
Langues |
|
Indien |
sanskrit* (éteint), |
|
Iranien |
avestique* (éteint), |
1
L'importance numérique des langues indo-iraniennes
Dans
la grande famille indo-européenne, c'est le groupe des langues
indo-iraniennes, appelées aussi indo-aryennes, qui constitue l'ensemble le plus
important (avant les langues germaniques, romanes et slaves), avec environ 500
ou 600 langues parlées par près de 700 millions de locuteurs.
|
|
L'aire linguistique des
langues indo-iraniennes s'étend du Kurdistan turc jusqu'au centre de l'Inde,
incluant une partie de l'Irak, puis pratiquement tout l'Iran, le Tadjikistan,
le Pakistan, l'Afghanistan, le Bengladesh, le Népal et le Sri Lanka. On divise généralement les
langues indo-iraniennes en deux groupes: une branche
indienne ou indo-aryenne (avec
l'hindi, le bengali, le marathi, le bihari, le gujarati, le panjabi, etc.) et
une branche iranienne (avec
le persan farsi, le persan dari et le persan tadjik, puis le pachtou, le
kurde, le baloutchi, etc.). Au moins 35 langues
indo-iraniennes sont parlées par plus de 10 millions de locuteurs, dont l'hindi (182 millions), le bengali (189 millions), le marathi (65 millions), l'ourdou (54 millions), le pendjabi (30 millions), l'assamais (15 millions), le singhalais (13 millions) et le népali (10 millions). Or, environ 80
langues dans le monde se trouvent dans cette situation. |
2
Les origines
Vers
le début du deuxième millénaire avant notre ère, les peuples indo-iraniens se
séparèrent des autres Indo-Européens restés au sud et à l'ouest de la Russie,
et émigrèrent vers l'est pour s’installer en Iran et envahirent le
sous-continent jusqu'alors habité par des peuples de souche dravidienne et de
souche mounda. C’est sans doute vers l'an 1000 avant notre ère que les langues
des peuples indo-iraniens se sont fragmentées entre une branche iranienne et
une branche indienne. Les langues iraniennes ont été utilisées du côté de
l'Iran et de l'Afghanistan, tandis que les langues indiennes se sont
développées dans le nord-ouest de l'Inde, au Bengladesh, au Pakistan, au Népal
(népali) et au Sri Lanka (singhalais). Si l’on fait exception du Sri Lanka,
toutes les langues du sud de l’Inde appartiennent à la famille dravidienne,
alors que les langues du nord font partie des langues indo-européennes.
Les
résultats les plus apparents de l’arrivée des Indiens dans le sous-continent
furent, pour l’essentiel, les suivants:
1)
le refoulement des Dravidiens au sud de la péninsule;
2) le confinement des peuples mounda dans une petite zone du centre-est de
l’Inde, où ils sont encore aujourd’hui;
3) la dispersion et l'éclatement de l'ethnie indienne en plusieurs ethnies:
Cachmiriens, Sindhis, Hindis, Goudjeratis, Mahrattes, Singhalais, Bengalis,
etc. Tel est encore aujourd'hui le peuplement actuel du sous-continent.
Ainsi,
à partir du sanscrit (langue commune indienne, identique au latin des
Occidentaux) et en passant par l'étape des «prakrits» (les «moyens Indiens» où
sont déjà sensibles les différences dialectales bases des futures langues), on
est arrivé aux environs de l'an 1000 à la constitution des entités
ethnolinguistiques actuelles. La stabilisation ethnolinguistique s'est donc
faite en Inde à peu près à la même époque qu'en Europe.
3
La branche indienne (aryenne)
|
|
La branche
indienne (ou aryenne) est composée de plus de 500 langues pratiquées par plus
de 600 millions de locuteurs dans les régions du nord et du centre du
sous-continent indien. Elle comprend le sanskrit, une langue disparue au
premier millénaire (avant notre ère), et de nombreuses langues modernes qui
en sont issues. En Inde, il faut
mentionner l’hindi (182 millions), le marathi (65
millions), le bihari (40 millions), le goudjarati (44
millions), le pendjabi (25,7 millions), l’oriya (31
millions), le radjashatni (20 millions), l’assamais (14,6
millions), le bundeli (8 millions), le konkani (2
millions), le pahari (6 millions), le santali (5,8 millions), etc. À ces
langues s’ajoutent le sindhi (19,6 milllions) et l'ourdou (54
millions) au Pakistan, le bengali (189
millions) au Bengladesh, le singhalais (13,2
millions) au Sri Lanka et
le népali (16 millions) au Népal. Malgré leurs noms
différents, l'hindi et l'ourdou constituent
deux variétés dialectales très proches l'une de l'autre, car ils ont déjà
constitué la même langue. Aujourd'hui, le vocabulaire hindi tend à dériver
principalement du sanskrit, tandis que l'ourdou contient de nombreux mots
d'origine persane et arabe. De plus, l'hindi utilise l'alphabet devanâgarî
alors que l'ourdou privilégie un alphabet arabe modifié d’influence persane.
Enfin, en Inde comme au Pakistan, l'hindi est parlé principalement par les
hindous, tandis que l'ourdou est utilisé essentiellement par les musulmans. |
Quant au terme d'hindoustani, il désigne le mélange d'ourdou
et d'hindi occidental qui s’est développé dans les camps et les marchés autour
de Delhi, s’est répandu dans toute l'Inde au cours des XVIIe et XVIIIe siècles
et a joué un rôle de langue véhiculaire parmi les différents groupes ethniques
de l'Empire mongol. En Inde, il existe deux grands groupes linguistiques:
les langues
indo-européennes au nord et les langues
dravidiennes au sud. Les premières représentent près des trois quarts
de la population; les langues dravidiennes, près du quart.
4
La branche iranienne
|
|
Les langues
iraniennes regroupent essentiellement l’avestique, une langue morte, mais
aussi de nombreuses autres plusieurs autres langues (environ une centaine)
qui en sont issues: le persan moderne ou farsi (26,5
millions) en Iran, l’afghan
ou pachtou (8,1 millions) en Afghanistan, le kurde (6 millions) en Turquie, en Syrie,
en Iran et en Irak, le baloutchi (1,6
million) au Pakistan, le tadjik
(4,3 millions) au Tadjikistan,
ainsi qu’un grand nombre de petites langues en Azerbaïdjan (kurmandji, talysh, tat,
etc.). Au total, on estime que les langues iraniennes sont parlées par plus
de 60 millions de locuteurs. |
5 Le sanskrit
Le sanskrit et
l’avestique ou védique (utilisés entre 1500 et 200 avant notre ère)
constituent deux variétés dialectales de l'ancienne langue indo-aryenne.
Techniquement, ce sont deux langues mortes à l’origine de toutes les langues
indo-iraniennes. Toutefois, depuis le début de l'ère chrétienne, le sanskrit a
été maintenu en Inde d'une façon plus ou moins artificielle comme la langue
littéraire du clergé et des castes cultivées et érudites. Il conserve encore ce
rôle aujourd’hui et s'écrit en alphabet devanâgarî. On estime que 200 000
Indiens utilisent ainsi le sanskrit comme langue seconde.
Le
sanskrit demeura une langue totalement inconnue des Occidentaux jusqu’au XVIIIe siècle.
La première grammaire sanskrite fut publiée en Europe en 1790. La découverte du
sanskrit par les Européens conduisit à la fois à l'identification de la famille
des langues indo-européennes et, en partie grâce à la méthodologie du
grammairien indien Panini, à l'établissement de la linguistique et de la
philologie comparées. Au XIXe siècle, des
linguistes allemands se sont rendu compte que, grâce au sanskrit et à
l’avestique, des langues comme le grec, le latin, l'allemand et l'anglais, le
russe et le polonais, l'arménien, l'albanais, etc., présentaient des éléments
communs remarquables. Ces ressemblances ont donné à penser que toutes ces
langues avaient une origine également commune. L'Allemand Franz Boop s'était
représenté les langues comme des êtres humains dont on pouvait suivre la
naissance, la vie et la mort. Selon cette même conception, les langues avaient
des «parents»; en ce sens, on parle de «langue mère», de «langues soeurs», de
«langues cousines», etc. C'est dans cet esprit que le qualificatif génétique a
été appliqué à la linguistique. Aujourd'hui, ce terme est utilisé de plus en
plus dans le sens de historique: lorsqu'on recherche des états de langue
anciens, il est légitime de penser en termes d'affiliation et de parenté
linguistique.
6
La langue tsigane (rom)
Les
Tsiganes, appelée aussi Romani, Rom, Bohémiens, etc., forment un peuple indo-européen
d’origine indienne. Il s’agit des Kshattriyas qui, venus du nord de l’Inde,
sont arrivés en Grèce au IXe siècle. Puis,
au XIIIe siècle, les Rajputs les ont rejoints.
Ensemble, ils ont formé la Romani Cel – le peuple tsigane –
d'où leur surnom de «Romanichels», mais ils se nomment eux-mêmes Romané
Chavé «fils de Ram» (héros de l'épopée indienne Ramanaya).
Comme
les Tsiganes n’ont pas d’État propre, ils sont dispersés non seulement à
travers l’Europe mais aussi dans toute l'Amérique. Bien qu'il n'existe aucun
recensement officiel, on estime que le nombre des Tsiganes serait d'environ 120
millions de personnes dans le monde en comptant ceux de l'Inde; ils habitent
sur tous les continents, de l'Argentine à l'Australie en passant par la Sibérie
et le Canada. Les estimations disponibles évaluent à près de deux millions leur
nombre dans l'Union européenne, avec une forte disparité selon les pays, mais
les Tsiganes sont beaucoup plus nombreux dans les anciens pays de l'Est
(environ huit millions). L'Europe totaliserait donc 10 millions de Tsiganes, ce
qui représenterait 85 % de la population estimée à environ 12 millions, à
l'exception de l'Inde où les Tsiganes devraient être de plus de 100 millions.
Avant la Seconde Guerre mondiale, on comptait approximativement 25 millions de
Tsiganes dispersés à travers toute l'Europe, dont 10 millions seulement se
reconnaissaient officiellement comme Tsiganes.
Il
est beaucoup plus difficile d'évaluer le nombre des locuteurs de
la langue tsigane. En effet, il n'existe pas de statistiques précises à ce
sujet, et l'on doit se fier à des approximations. Il en résulte que toute
estimation ne peut se révéler que partiale et suspecte. Par exemple, en ne
tenant compte que des Tsiganes d'Europe et de l'Amérique, certains linguistes
croient que les deux tiers des Tsiganes parleraient encore une forme de leur
langue ancestrale, ce qui signifierait huit millions de tsiganophones. Pour sa
part, le Summer Institut of Linguistics du Texas évalue le nombre des
tsiganophones à 1,5 million de locuteurs. En 1989, l'Union soviétique les
estimait à 202 810. Quant à l'Unesco, elle affirmait en 2002 que le tsigane
était une langue en danger d'extinction. En somme, on peut croire que la
plupart des Tsiganes auraient perdu l’usage de leur langue ancestrale et se
seraient assimilés dans leur pays d’accueil.
Quoi
qu'il en soit, les tsiganophones habitent surtout la Bosnie-Herzégovine, la
Roumanie, la Pologne, la Hongrie, l’Albanie, la Grèce, la Slovaquie, l’Ukraine,
le Portugal, l’Espagne, la Norvège, la Suède, la France, les Pays-Bas, l’Italie
et l’Allemagne. On distingue le tsigane des Balkans (Pologne), le tsigane des
Carpates (République tchèque), le tsigane finnois (Finlande), le tsigane sinté
(Serbie), le tsigane gallois (pays de Galles), le tsigane valaque (Roumanie),
le tsigane gréco-turc, etc. Si les locuteurs du tsigane sont peu nombreux
(environ 1,5 million de locuteurs), les Tsiganes eux-mêmes sont beaucoup plus
nombreux, probablement plus de 10 millions.
La
langue romani ou tsigane reste l’unique
représentante européenne du groupe indo-iranien appartenant à la famille
indo-européenne. Le romani a préservé en grande partie
l'héritage des langues de l'Inde du Nord, plus particulièrement le hindi et le
rajasthani dont il a en commun 60 % du vocabulaire de base. Enfin, le romani ou
tsigane est parfois considéré comme appartenant au sous-groupe indien ou même
comme une troisième branche indo-iranienne avec comme seule langue le tsigane.
Bien que la langue des Tsiganes puise son origine dans le sanskrit et d'autres
langues du nord de l'Inde, elle s'est fragmentée en de multiples variétés
dialectales enrichies de termes persans, arméniens, grecs, slaves ou roumains;
depuis quelques décennies, des racines anglo-saxonnes ont imprégné le
vocabulaire moderne, technique et scientifique. Les variétés tsiganes de l'Europe
de l'Est ont conservé la grammaire indienne ainsi qu'un bon fonds lexical
d'origine sanskrite. Cependant, les variétés tsiganes de l'Ouest se sont
créolisés pour devenir l'anglo-romani (anglicisé), le manouche (germanisé), le
sinto italien, le calo (hispanisé), etc. De façon générale, les jeunes
générations semblent abandonner progressivement la langue ancestrale, ce qui
peut être ressentie comme une perte de l'identité tsigane. Depuis quelque
temps, la langue a été dotée d'un alphabet et fait l'objet d'une
standardisation.
![]()